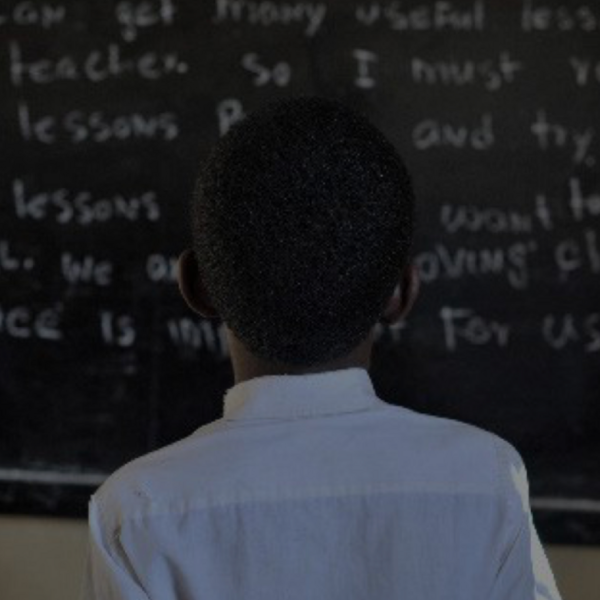
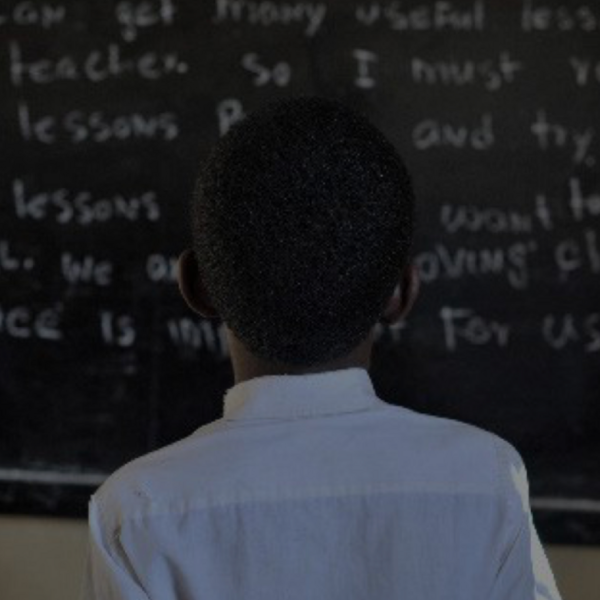
Organisation : UNICEF et Commission de l’Union africaine
Site de publication : UNICEF
Type de publication : Rapport
Date de publication : Octobre 2021
Lien vers le document original
Le secteur de l’éducation en Afrique : en dépit des progrès récents, des disparités persistent
Les enfants jouent un rôle déterminant dans l’avenir de l’Afrique. D’ici à 2050, le continent comptera un milliard d’enfants et d’adolescents âgés de moins de 18 ans, soit près de 40 % du total mondial. Vu l’importance grandissante de cette jeunesse, les pays africains doivent faire en sorte que cette croissance démographique ne soit pas un fardeau, mais un atout ; l’occasion s’offre à eux de multiplier les possibilités à la disposition des jeunes, et de tirer parti du capital humain essentiel qu’ils représentent.
Redoubler d’efforts en faveur d’une éducation de base de qualité et universelle contribue de manière déterminante à renforcer la résilience des populations ainsi qu’à transformer ce qui pourrait constituer un fardeau démographique en un dividende démographique précieux. Ces résultats sont possibles grâce à la consolidation de la citoyenneté et à la création d’une main-d’œuvre qualifiée et apte à l’emploi, dont les compétences et les aptitudes correspondent aux besoins du marché du travail. L’Union africaine considère l’éducation comme une priorité absolue du développement. La Déclaration de Kigali définit quant à elle certaines des priorités régionales qui doivent guider les efforts des pays subsahariens en vue d’atteindre les objectifs de l’initiative Éducation 2030, à savoir, l’accès équitable et universel à l’éducation, l’éducation en faveur du développement durable et de la citoyenneté mondiale, et l’alphabétisation, les compétences et les aptitudes des jeunes et des adultes.
Situation du secteur éducatif en Afrique
Une population jeune en croissance rapide
Avec trois personnes sur cinq âgées de moins de 25 ans et 50 % de la population âgée de 3 à 24 ans, l’Afrique est le continent le plus jeune. En 2020, près de 800 millions de personnes avaient moins de 25 ans et 677 millions avaient entre 3 et 24 ans. Outre sa jeunesse, la population de l’Afrique connaît également une croissance rapide. Depuis l’an 2000, le nombre de personnes âgées de 3 à 24 ans a augmenté de 58 %, et, d’après les estimations, il devrait s’accroître encore de 22 % au cours des dix prochaines années. D’après les estimations, les seules régions au monde où la population de jeunes (âgés de moins de 25 ans) devrait augmenter au cours de la prochaine décennie sont l’Afrique (21 %) et l’Océanie (9 %). Si l’on en croit les projections démographiques des Nations Unies, en 2030, l’Afrique abritera 28 % de la population mondiale âgée de 3 à 24 ans, contre 17 % en 2000 et 25 % en 2020.
Les niveaux élevés d’analphabétisme chez les adultes entravent la scolarisation des enfants
En dépit des progrès importants relevés en matière d’alphabétisation à l’échelle du continent, une grande partie de la population africaine est toujours analphabète. En 2018, environ une personne sur trois âgées de 25 à 64 ans, et un jeune sur cinq âgés de 15 à 24 ans étaient analphabètes. À l’échelle du continent, le taux moyen d’analphabétisme des adultes varie de 52 % en Afrique de l’Ouest à 79 % en Afrique australe. Avec près d’un adulte sur deux concerné, l’Afrique de l’Ouest concentre quasiment un tiers de la population adulte analphabète africaine. Le phénomène est également répandu en Afrique centrale, où un adulte sur trois est analphabète.
L’Afrique aura besoin de 17 millions d’enseignants supplémentaires pour instaurer l’accès universel à l’enseignement primaire et secondaire d’ici à 2030.
Pénurie d’enseignants qualifiés
Il va sans dire que les enseignants contribuent de manière déterminante à l’apprentissage et au renforcement des compétences des enfants, en particulier pendant les premières années de scolarisation. D’après Bissonnette et al. (2005), ils influent profondément sur le processus d’apprentissage de leurs élèves. Certaines recherches affichent des résultats mitigés quant au lien entre la formation initiale des enseignants et la réussite scolaire des élèves. Cependant, ce n’est pas tant le principe que le type ou le contenu de la formation qui est souvent remis en question (IIPE). La nécessité de disposer d’un vivier d’enseignants formés et qualifiés fait l’unanimité et constitue la cible 4.c des ODD (« D’ici à 2030, accroître nettement le nombre d’enseignants qualifiés, notamment au moyen de la coopération internationale pour la formation d’enseignants dans les pays en développement, surtout dans les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement »).
On observe des différences importantes en fonction des pays. À titre d’exemple, au Togo, la prise en compte des enseignants non qualifiés réduit sensiblement le ratio élèves enseignant dans le primaire (43 élèves par enseignant) ; si seuls les enseignants qualifiés avaient été pris en considération, ce ratio serait de 91 élèves par enseignant.
L’Afrique aura besoin de 17 millions d’enseignants supplémentaires pour instaurer l’accès universel à l’enseignement primaire et secondaire d’ici à 2030
Sur le continent, le nombre moyen d’élèves par enseignant qualifié dans le primaire s’étend de 15 (Maurice) à 91 (Togo). Les pays d’Afrique du Nord affichent les ratios les plus bas, avec en moyenne 22 élèves par enseignant qualifié du primaire, tandis qu’avec un ratio moyen de 54, l’Afrique Centrale enregistre la moyenne régionale la plus élevée.
Mauvaise gestion des enseignants
Outre les problèmes liés au nombre d’enseignants, à leurs qualifications et à leur formation, leur gestion représente également un écueil supplémentaire. Plusieurs études, dont des analyses sectorielles, ont montré que dans certains pays africains, la gestion administrative et pédagogique des enseignants souffre de graves lacunes. Une gestion inadéquate peut influer négativement sur le comportement des enseignants et de leurs responsables et, partant, sur l’efficacité et la qualité des systèmes éducatifs.
Les enjeux en matière de gestion comprennent notamment le déploiement des enseignants, l’organisation de leur carrière, leur formation, leur perfectionnement professionnel (y compris l’appui et la supervision pédagogiques), leur rémunération et d’autres incitations, ainsi que leur redevabilité. S’appuyant sur plusieurs analyses sectorielles menées dans les pays africains, le bureau de l’IIPE à Dakar a constaté que le déploiement des enseignants dans les établissements publics est souvent déterminé par des facteurs autres que le nombre d’élèves. En estimant la proportion des déploiements d’enseignants qui ne dépendent pas du nombre d’élèves, il est possible d’évaluer le degré de cohérence de l’affectation des enseignants. Parmi les 22 pays pour lesquels il existe des données concernant les déploiements dans l’enseignement primaire datant de 2010 ou après, cette proportion varie entre 8 % (Zimbabwe) et 73 % (Bénin), pour une moyenne à 33 %.
Analyse de l’équité : de nombreux enfants continuent d’être exclus de l’éducation
Disparités en matière d’éducation entre les garçons et les filles, les riches et les pauvres, le milieu urbain et le milieu rural
Pour certains enfants africains, aller à l’école reste un rêve hors d’atteinte. Près d’un enfant sur cinq en âge de fréquenter le primaire n’est pas scolarisé. Si globalement les inégalités fondées sur le genre en matière de fréquentation scolaire ont fortement diminué, voire ont pratiquement disparu en moyenne pour les enfants en âge de fréquenter le premier cycle du secondaire ou plus jeunes, les inégalités liées à la situation économique des enfants, ainsi qu’à leur lieu de résidence, sont toujours courantes. Les enfants issus de familles pauvres et ceux qui vivent en milieu rural continuent de se heurter aux inégalités.
Une mesure globale des inégalités dans ces trois dimensions (genre, richesse et lieu de résidence) permet de comparer les régions et les pays. L’indice d’équité, calculé à partir du taux d’achèvement du premier cycle du secondaire, révèle que l’Afrique de l’Ouest suivie de l’Afrique centrale sont les régions où les inégalités sont les plus fortes, tandis que l’Afrique du Nord est celle où l’égalité est la plus répandue. Au niveau des pays africains, l’Angola, l’Éthiopie, le Niger et le Tchad affichent les inégalités les plus criantes.
Enseignements tirés de la riposte du secteur de l’éducation face à la COVID-19 et à d’autres épidémies
Les enseignements tirés de la COVID-19 et d’autres pandémies, comme l’épidémie de maladie à virus Ebola, contribueront à faire évoluer les politiques afin qu’elles œuvrent davantage à établir des systèmes éducatifs inclusifs et résilients en Afrique et ailleurs. La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l’importance pour la communauté internationale de s’armer d’un esprit novateur pour repenser la prochaine génération de systèmes éducatifs, où les nouvelles technologies et d’autres innovations seront des outils essentiels pour l’enseignement et pour offrir des possibilités d’apprentissage, et ce, afin d’atteindre les groupes les plus défavorisés et vulnérables.
À travers le monde, les pays ont, à la suite de la fermeture des établissements scolaires, eu recours à différentes modalités d’apprentissage, dont certaines étaient exclusivement à distance et d’autres hybrides, ainsi qu’à d’autres mesures visant à atténuer les éventuelles pertes d’apprentissage. En dépit des efforts, les données probantes nationales montrent qu’une grande proportion d’élèves n’avaient pas accès, ou ne participaient pas, à l’apprentissage à distance fourni. En Afrique de l’Ouest et centrale, environ 48 % des élèves (54 millions) n’ont pas bénéficié de l’apprentissage numérique ou diffusé. Les principales raisons en sont, tout d’abord, le manque de disponibilité de l’apprentissage à distance (dans plusieurs pays, il ne concernait que certains niveaux d’enseignement), puis le fait que les élèves, notamment en milieu rural, n’avaient pas d’ordinateur ou de connexion Internet chez eux.
Résorber la fracture numérique en Afrique
Dans toute l’Afrique, des obstacles empêchent les enfants et les jeunes d’accéder à la technologie ou aux outils numériques et de les utiliser. Le problème est multidimensionnel : on constate des écarts en matière d’accès à Internet et à la téléphonie mobile, d’accès aux services d’Internet mobiles et de capacité à les utiliser, de capacité à créer des technologies, et d’aptitudes minimales à se servir des outils numériques. À l’heure actuelle, 34 % des ménages africains ont accès à Internet et environ 89 % des apprenants n’ont pas d’ordinateur chez eux. Seuls 53 % des élèves en Afrique du Nord et 8 % en Afrique subsaharienne ont accès à un ordinateur. En Afrique subsaharienne toujours, seuls 14 % des élèves ont Internet à domicile.
S’agissant de l’accès à Internet et à un ordinateur dans les établissements scolaires, des données probantes montrent que dans au moins cinq pays africains – Botswana, Cabo Verde, Mauritanie, Tanzanie et Tunisie – les élèves fréquentant le premier cycle du secondaire ont accès à des ordinateurs à des fins pédagogiques.
Explorer d’autres moyens de fournir un enseignement à distance
Pour opérer la transition vers l’apprentissage à distance, les gouvernements ont dû relever de nombreux défis, dont la faible capacité institutionnelle d’appui aux enseignants, l’accès insuffisant aux populations vulnérables, et l’absence de politiques de soutien et de financements cohérents. Pour faire face à la fermeture d’établissements scolaires due à la COVID-19, des solutions peu coûteuses et/ou hautement technologiques ont été mises en place, allant des supports pédagogiques sur papier à emporter chez soi à la diffusion des leçons dans les médias, principalement à la télévision, à la radio et sur les plateformes numériques, tant en ligne que hors ligne. L’éventail de solutions permettant d’assurer l’apprentissage à distance a ainsi été mis en évidence ; il importe non seulement de les maintenir, mais également de les développer afin de faire face à de futures perturbations de l’apprentissage.
Aller de l’avant : recommandations visant à transformer les systèmes éducatifs africains au lendemain de la pandémie de COVID-19
- Faire des écoles des environnements sûrs et sains pour les élèves
Au lendemain de la pandémie de COVID-19, il est plus important que jamais d’adopter des directives et des protocoles en matière de services EAH (eau, assainissement, hygiène). Par ailleurs, en tant qu’espaces d’apprentissage sûrs, les établissements scolaires doivent également assurer des services essentiels, comme le soutien psychologique et psychosocial et les programmes de repas scolaires.
Les pays africains peuvent œuvrer à cela en élaborant des politiques et des directives relatives à la mise en place d’installations EAH adéquates, y compris des services d’approvisionnement en eau potable, des points pour le lavage des mains, des produits de nettoyage, et des toilettes ou latrines séparées pour les filles et les garçons. Ils doivent également affecter des ressources, en particulier financières, aux établissements scolaires afin qu’ils aménagent de nouvelles installations conformes aux directives relatives aux services EAH, modernisent les infrastructures existantes, fournissent des services psychologiques, et veillent à la formation des enseignants et du personnel scolaire.
- Rendre les écoles plus inclusives, notamment à l’égard des groupes à risque d’abandon scolaire
Le pilier central de la vision de la CESA 2016-2025 est de « ne laisser personne de côté ». En dépit de progrès notables dans l’accessibilité de l’enseignement primaire, un nombre important d’élèves continuent d’abandonner l’école. Étant donné que dans l’ensemble de l’Afrique, le taux d’enfants non scolarisés est plus élevé dans le deuxième cycle du secondaire que dans le primaire et dans le premier cycle du secondaire, il est urgent de résoudre le problème du faible taux de fréquentation du secondaire.
- Mettre l’accent sur les savoirs fondamentaux dès le plus jeune âge afin d’améliorer les niveaux d’apprentissage
Pour améliorer les niveaux d’apprentissage des élèves, les systèmes éducatifs africains doivent renforcer les compétences fondamentales en lecture, en écriture et en calcul. L’enseignement précoce de ces disciplines favorise la réussite. En mettant l’accent sur l’enseignement des fondamentaux en lecture et en mathématiques aux niveaux préscolaire et primaire, les pays africains peuvent optimiser les effets de l’apprentissage et améliorer la qualité globale de l’éducation.
- Privilégier l’enseignement des compétences numériques dans les écoles en gardant un œil tourné vers l’avenir
Les systèmes éducatifs africains qui, à l’heure actuelle, n’enseignent pas les compétences numériques essentielles au sein des établissements ou ne fournissent pas une formation adéquate aux jeunes font peser un lourd fardeau sur l’avenir de ces derniers. Les gouvernements doivent accroître leur budget d’appui à la modification des programmes scolaires afin de les adapter aux enfants et aux jeunes qui grandissent dans un monde de plus en plus dominé par les technologies numériques.
